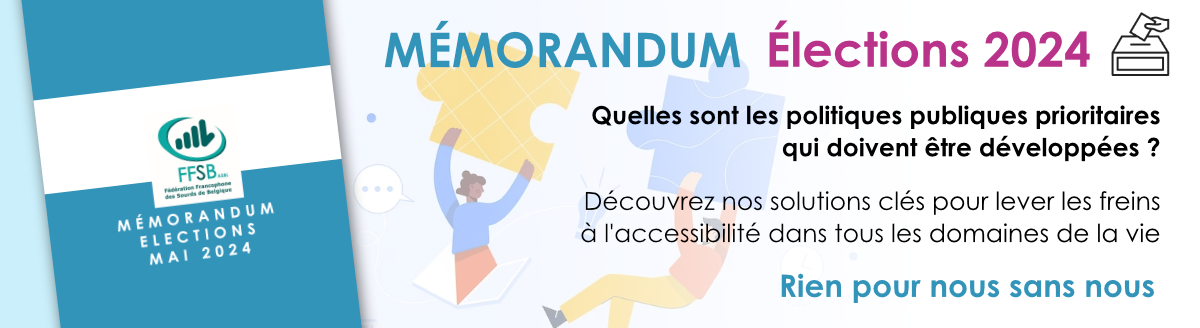L’interprétation par les personnes sourdes
La deuxième conférence du cycle Les Quatre Matins s’est déroulée, ce 19 juin 2024, à la Bastide, à Namur. Cette conférence s’est concentrée sur l’interprétation et la traduction en langue des signes par les personnes sourdes, dite aussi « le métier d’interprète sourd ». L’objectif de cette conférence (et de l’analyse qui s’en suit) est d’apporter à la communauté sourde, principalement, et à la société, plus largement, une vulgarisation au sujet d’un métier émergent, c’est-à-dire d’une profession en voie d’être reconnue officiellement et de plus en plus généralisée dans la vie quotidienne. Cette matinée de conférence a été présentée par la Doctoresse Amandine Lemaire, Madame Julie Carlier et Monsieur Thierry Haesenne. À la suite de leur intervention, des échanges enrichissants avec la salle ont pu être entamés. Prenant appui sur les présentations des parties intervenantes ainsi que sur les échanges avec le public, la présente analyse vise, dans un premier temps, à discuter, au niveau théorique, des métiers de l’interprétation et de la traduction exercée par les personnes sourdes (I), avant d’appréhender, dans la foulée, les défis propres à cette problématique spécifique (II).
 I) Le métier d’interprète sourd : une réalité méconnue
I) Le métier d’interprète sourd : une réalité méconnue
De tout temps, des personnes sourdes ont, spontanément ou sur demande, proposé leur intervention pour faciliter le dialogue entre leurs pairs sourds ou dans leurs interactions avec leurs interlocuteurs entendants. Cela peut être le résultat de l’initiative d’un élève sourd dans une école spécialisée envers son camarade, lui-même sourd, et un enseignant entendant (qui maitrise mal ou peu la langue des signes). Cela peut advenir dans le cadre d’une performance d’art de rue, durant laquelle une personne sourde interprète spontanément ce qui est joué à ses amis sourds. Cette situation peut encore être le fruit d’une prise de décision de la part d’une personne sourde qui met en contact deux de ses connaissances bloquées par la barrière de la langue (comme, en quelques sortes, un belge francophone qui mettrait en contact un ami français et un ami flamand, en passant d’une langue à l’autre).
Relativement fréquentes au quotidien, ces contributions individuelles sont une réalité familière pour les membres de la communauté sourde, alors que la plupart des personnes entendantes en ignorent l’existence. Avec l’essor de la télévision, de l’internet et de l’accessibilité communicationnelle en général, les contextes contemporains sont de plus en plus variés : l’interprète sourd peut être présent, entre autres, dans un festival culturel, une exposition muséale, une conférence de presse gouvernementale, sur les vidéos en langue des signes des sites internet de certaines administrations, voire au journal télévisé. Dans la suite de cette analyse, nous discutons de manière critique le métier de l’interprète sourd, tantôt en termes de fonction et de compétence (A), tantôt au regard de ses limites (B).
A) Le métier d’interprète sourd : fonction et compétence
Fondamentalement, le métier d’interprète sourd consiste à transmettre une information donnée depuis une langue source vers une langue cible et ce, de manière bidirectionnelle (puisque c’est la spécificité de l’interprétation en langue des signes). En général, l’interprétation faite par une personne sourde est interlinguistique : l’interprète sourd va proposer son aide à deux interlocuteurs parlant deux langues des signes différentes qu’il connait ˗ par exemple, la langue des signes de Belgique francophone (ci-après la LSFB, selon l’acronyme officiel1 ) et la langue des signes allemande (ci-après la DGS, selon l’acronyme en langue allemande) – ou encore entre un pair de sa communauté et une personne entendante (par exemple, la LSFB et le français). Plus rarement, l’interprétation faite par une personne sourde peut être intralinguistique : c’est par exemple le cas lorsque deux personnes sourdes appartiennent à la même communauté de langue des signes, mais parlent deux variantes très différentes l’une de l’autre. Cette réalité existe aussi en Belgique, au sein de la communauté sourde qui pratique la LSFB. Cette diversité peut être due à la vivacité de la langue qui produit régulièrement de nouveaux signes non encore stabilisés (c’est-à-dire employés usuellement par l’ensemble de la communauté) ou encore par l’emprunt plus ou moins prononcé de signes stabilisés à d’autres langues des signes plus installées ou plus influentes (c’est principalement le cas des langues des signes française et américaine). De même, la variation intralinguistique peut s’avérer d’ordre générationnel lorsque certains signes sont en voie d’extinction car usités principalement par les personnes les plus âgées, mais ne sont guère plus employés par les plus jeunes.
En général l’interprétation par des personnes sourdes se fait en collaboration avec d’autres interprètes, en situation d’interprétation de liaison, ou « proximité » (généralement privées ou individuelles, dans différentes situations), ou sous la forme d’une interprétation tactile au bénéfice principal de personnes sourdaveugles. Quelle que soit la diversité de leur public, les interprètes entendants et sourds doivent s’adapter à l’échange en fonction des personnes sourdes. Ainsi, le degré d’adaptation ne sera pas le même face à un public dans une conférence ou dans un échange interpersonnel. Dans le premier cas, l’interprète doit estimer la moyenne d’usage, en termes de niveau de langue, alors que dans le second, l’interprète doit s’adapter à l’individu sourd (ou aux quelques individus sourds) isolément pris. En ce sens, la maitrise des différents registres de langue, en langues audio-vocales et signées s’avère essentiel dans le métier de l’interprétation en langue des signes. Le but est de garder, le plus possible, le registre des deux interlocuteurs, tant que cela ne nuit pas à l’échange communicationnel. Cela peut impliquer, notamment, d’interpréter dans des registres différents afin de s’adapter aux codes communicationnels de chaque partie. Par exemple, un interprète sourd pourrait employer un registre plus soutenu avec une autorité publique, conformément à ses schémas communicationnels, tout en employant un registre plus courant, voire familier au besoin, avec une personne sourde peu instruite, voire illettrée.
Puisqu’il s’agit d’un métier de communication, l’interprétation ne se confond pas avec le métier de la médiation. Si ces deux métiers, très différents, impliquent une adaptation culturelle et une maitrise conséquente du répertoire communicationnel en général, l’interprétation se limite à reformuler dans une langue cible le propos d’une langue source, tandis que la médiation consiste en un accompagnement individualisé et approfondi de la personne sourde par un professionnel (sourd ou entendant). En ce sens, la personne sourde qui propose ses services en tant qu’interprète se limite à transmettre le message d’une langue à l’autre, éventuellement de manière bidirectionnelle. Son but n’est pas d’accompagner la personne sourde dans ses démarches, mais de s’assurer que le dialogue échangé soit clair pour les deux parties prenantes. S’il existe bien une préparation de l’échange en amont (comme pour l’interprète entendant), le rôle de l’interprète sourd ne se confond pas avec une aide dans les démarches entreprises par la personne sourde : il existe une distance certaine entre le prestataire sourd et l’usager sourd ou entendant. Néanmoins, il arrive souvent que pour le public sourd, la frontière ne soit pas aussi claire et des demandes de médiation peuvent accompagner la demande d’interprétation formulée par une personne sourde : il appartient à l’interprète sourd de clairement établir les limites de ses missions avec son usager sourd afin d’éviter les frustrations de part et d’autre2.
Tout comme chaque personne entendante n’est pas naturellement destinée à devenir une interprète professionnelle en langue vocale, il n’est pas non plus donné à toutes les personnes sourdes de devenir interprète en langue des signes. Le métier d’interprète sourd exige des compétences particulières, liées à l’adaptation culturelle et linguistique des mondes sourds et entendants qui, d’ordinaire, vivent en parallèle l’un de l’autre. Les compétences développées par les interprètes sourds doivent correspondre aux exigences du métier d’interprète (telles la clarté et la fidélité du message interprété) ainsi qu’aux règles déontologiques de ce corps professionnel (comme la neutralité de l’interprète et l’obligation du secret professionnel dans son chef). Plus généralement, la compétence primordiale à acquérir consiste en la capacité d’adaptation du message au contexte de l’échange, à la personne ou au public visé, ou encore au répertoire communicationnel (dans le cas des variations intralinguistiques propres à une langue des signes donnée). Dans cette perspective d’adaptation, l’interprète sourd doit, non seulement, maitriser presque parfaitement – c’est-à-dire au niveau C1 du cadre européen de référence des langues – les langues des signes (ou une langue des signes et une langue audio-vocale), mais aussi le bagage culturel propre à chaque communauté linguistique (c’est, d’ailleurs, l’un des plus grands avantages de l’interprète sourd par rapport à son homologue entendant).
Enfin, l’interprète ou traducteur sourd peut travailler en binôme avec un collègue entendant ou bien seul. Lorsqu’un interprète sourd et un collègue entendant travaillent ensemble pour une même mission, la situation est qualifiée de co-interprétation3. Mais le professionnel sourd peut aussi décider de travailler seul lorsqu’il s’agit de traduire un texte d’une langue audio-vocale vers sa langue des signes ; parfois, il peut aussi se retrouver seul dans le cadre d’un échange conversationnel : l’interprète sourd aura alors recours à une application ou un logiciel de retranscription pour lui venir en aide. Mais cette solution ne constitue pas la panacée. D’une part, le recours à la retranscription prend plus de temps que dans le cadre de la co-interprétation. D’autre part, l’emploi de l’outil numérique peut être rendu difficile si l’interlocuteur entendant parle avec un accent non-reconnu par le programme de retranscription ou s’exprime dans un environnement bruyant. Il est aussi possible que l’interprète sourd soit perdu face à un mode de prononciation trop différent de la communauté entendante avec laquelle il a l’habitude d’évoluer. À titre illustratif, il peut être difficile pour un interprète sourd belge, même très expérimenté, de lire sur les lèvres d’une personne entendante québécoise car ses mouvements labiaux sont différents en raison de l’accent (par exemple, certains « a » sont très proches d’un « ô », ce qui peut prêter à confusion pour le professionnel sourd). À l’inverse, ce genre de situation existe aussi pour les interprètes entendants qui, confrontés à des personnes sourdes très âgées (parfois dotées d’une variante quasiment éteinte de la langue des signes employée), se sentent dépassés et proposent une interprétation moins fine de l’échange : la présence d’un co-interprète sourd leur permet alors de surmonter cette difficulté (cela nécessite, au passage, une remise en question professionnelle, ce qui n’est pas toujours évident de prime abord).
B) Les limites de l’interprète sourd
 À l’instar de ses pairs entendants, l’interprète sourd ne peut pas tout faire. D’une part, il doit respecter un code de déontologie ; d’autre part, l’interprète sourd est confronté à des limites d’ordre pratique et juridique.
À l’instar de ses pairs entendants, l’interprète sourd ne peut pas tout faire. D’une part, il doit respecter un code de déontologie ; d’autre part, l’interprète sourd est confronté à des limites d’ordre pratique et juridique.
D’un point de vue déontologique, les mêmes règles professionnelles s’appliquent aux interprètes sourds et entendants. Ce corps de métier doit être composé de professionnels, c’est-à-dire d’individus formés et diplômés afin de garantir la qualité de leurs prestations. Le but est d’éviter les interprètes auto-proclamés qui peuvent ne pas respecter les règles déontologiques en vigueur (puisqu’ils n’y sont pas tenus), voire, dans le pire des scenarii, se révéler n’être que de vulgaires escrocs4. La question du diplôme, et donc des formations, pose la problématique de l’égalité des chances en matière d’accès à l’enseignement supérieur, domaine qui manque encore cruellement d’un soutien approprié vis-à-vis du corps étudiant sourd. Au sujet de l’interprétation en langue des signes par les personnes sourdes, seule une formation ponctuelle certificative existe pour l’année 2023-2024, à l’initiative de deux universités belges et d’une université française (cf. infra, le point II, B). Il y aurait pourtant besoin de pérenniser ce genre de formation et de l’améliorer pour en faire une finalité à part entière du master en interprétation et traduction en langue des signes. Malgré les limites du certificat actuel, les acteurs du terrain, dont l’association belge francophone des interprètes, traducteurs et traductrices en langue des signe (ci-après l’ABILS) soutiennent cette initiative et entretiennent l’espoir de son développement à l’avenir.
Dans une perspective plus pratique, les interprètes sourds ne sont pas adaptés à tous les contextes. Par exemple, la triangulation impliquée par l’interprétation en langue des signes montre des limites dans le cadre de l’enseignement obligatoire, situation interpersonnelle où la relation de l’élève et de son enseignant joue un rôle prépondérant dans la compréhension de la matière et la réussite scolaire de l’apprenant. Dans cet exemple, les limites de l’interprétation (dues à la triangulation) s’appliquent donc aussi bien aux interprètes sourds qu’entendants. Une autre limite est celle d’une situation dans laquelle l’espace prévu pour l’échange n’est pas adapté en vue d’accueillir un co-interprète sourd.
Au-delà des limites propres au métier d’interprète sourd, la question de la prestation de l’interprète se pose sous l’angle du régime juridique du droit à un aménagement raisonnable5. Ainsi, si le prestataire propose déjà un service d’interprétation par des professionnels entendants, celui-là peut écarter les demandes à bénéficier de la présence d’un interprète sourd faites par des personnes sourdes au motif qu’il s’agit d’une demande non-nécessaire et, par voie de conséquence, déraisonnable6. De même, au regard de la balance des intérêts, le coût financier doit être correctement évalué. Ainsi, au regard du régime juridique des aménagements raisonnables, le recours à un interprète sourd, en plus de l’interprète entendant, peut être financièrement disproportionné pour une petite entreprise, un indépendant ou une association sans but lucratif peu subsidiée. En effet, la prestation est payée en double par le débiteur d’un tel accommodement (on voit mal comment la prestation serait divisée par deux car ce serait alors forcer les prestataires à travailler au rabais), ce qui peut se révéler une charge excessive pour l’interlocuteur de la personne sourde. Une manière de contourner cet obstacle financier serait que les deux interprètes – l’un sourd, l’autre entendant – s’associent. Une autre option, plus difficile à mettre en œuvre encore, est l’engagement d’un interprète sourd par un interprète entendant (ou vice-versa) : cela est peu probable car les charges sociales sont alors assumées par l’une des parties, tandis que l’autre perd son autonomie en raison du lien de subordination qui le place sous la direction de son collègue ; en revanche, cette solution est envisageable dans le cadre d’un service d’interprétation où les interprètes sourds et entendants peuvent travailler en équipe, sous une direction bilingue commune. Quoiqu’il en soit, les interprètes sourds plaident pour une réforme du système d’heures subventionnées par l’AVIQ et le PHARE afin de pouvoir comptabiliser les heures de travail des interprètes sourds aux côtés de leurs collègues entendants. Cette réforme se doit d’être soutenable financièrement pour les débiteurs des aménagements raisonnables et équitables pour les duos (ou, plus rarement, trios) d’interprètes sourds-entendants. En d’autres termes, il faut augmenter les budgets publics pour rajouter progressivement des interprètes sourds aux côtés des interprètes entendants en vue d’une collaboration fructueuse et non d’une concurrence indue au détriment de la qualité de la prestation et des droits des usagers sourds.
II) Le métier d’interprète sourd : un avenir à dessiner
De tout temps, les personnes sourdes ont été confrontées au monde entendant, ultra-majoritaire et dominant. Parmi ces personnes, certaines ont pris spontanément l’initiative de garantir une correcte intercompréhension entre leurs contemporains sourds et entendants. C’était, par exemple, le cas de certains enfants sourds qui traduisaient en langue des signes les informations du corps pédagogique ou éducatif à leurs camarades de classes ou de dortoirs, dans les institutions de l’enseignement spécialisé. C’est aussi le cas d’adultes sourds qui aident leurs pairs dans leurs relations avec les pouvoirs publics ou les professions libérales. Alors que certaines personnes sourdes ont adopté une posture de médiation culturelle, d’autres ont pris en charge une fonction plus neutre : celle d’interprète. Les interprètes sourds ont donc toujours existé, pour des raisons pratiques liées à la bonne intelligence mutuelle entre les personnes sourdes et entendantes dans leurs échanges communicationnels. En ce sens, les interprètes sourds jouent également un rôle pertinent dans l’inclusion de leurs pairs sourds (A). Au XXIè siècle, le défi principal pour ces travailleurs et travailleuses se situe dans la professionnalisation de ce métier émergent (B).
A) La valeur ajoutée de l’interprète sourd
 L’embauche d’interprètes sourds ou le recours à leurs services en tant qu’indépendants posent la question de leur valeur ajoutée sur le marché de l’emploi. À l’heure actuelle, nul n’est tenu d’embaucher ou de recourir à la prestation d’un interprète sourd parce qu’il est sourd. En revanche, ce qui compte est la qualité de la prestation, élément qui tend à être renforcé chez les personnes sourdes grâce à leur meilleure connaissance de la communauté sourde et de la langue des signes, par rapport à leurs collègues entendants (cf. supra, le point I, A). Toujours est-il que les services subventionnés d’interprétation en langue des signes, comme les Services d’interprétation en langues des signes de Wallonie ou de Bruxelles, ci-après le SISW et le SISB, devront se poser tôt ou tard la question de la présence en leur sein d’interprètes sourds professionnels et devront, sans aucun doute, discuter avec les administrations pertinentes (respectivement l’AVIQ et le PHARE) en vue de subsides pertinents afin d’adapter leur poste de travail ou tout autre élément essentiel à leur connaissance.
L’embauche d’interprètes sourds ou le recours à leurs services en tant qu’indépendants posent la question de leur valeur ajoutée sur le marché de l’emploi. À l’heure actuelle, nul n’est tenu d’embaucher ou de recourir à la prestation d’un interprète sourd parce qu’il est sourd. En revanche, ce qui compte est la qualité de la prestation, élément qui tend à être renforcé chez les personnes sourdes grâce à leur meilleure connaissance de la communauté sourde et de la langue des signes, par rapport à leurs collègues entendants (cf. supra, le point I, A). Toujours est-il que les services subventionnés d’interprétation en langue des signes, comme les Services d’interprétation en langues des signes de Wallonie ou de Bruxelles, ci-après le SISW et le SISB, devront se poser tôt ou tard la question de la présence en leur sein d’interprètes sourds professionnels et devront, sans aucun doute, discuter avec les administrations pertinentes (respectivement l’AVIQ et le PHARE) en vue de subsides pertinents afin d’adapter leur poste de travail ou tout autre élément essentiel à leur connaissance.
La valeur ajoutée de l’interprétation ou de la traduction par les personnes sourdes a déjà été démontrée ailleurs et par d’autres personnes plus qualifiées que nous pour cela7. Nous retenons, pour la présente analyse, que ce modus operandi assure une meilleure compréhension des enjeux de la part des usagers sourds, une amélioration de leur confiance dans le cadre de l’échange avec la personne entendante ainsi que le renforcement d’une dimension d’empowerement des membres d’une minorité. Concernant ce dernier point, la présence de l’interprète sourd permet aux usagers sourds de prendre confiance en eux et, partant, d’oser s’engager dans l’échange avec son ou ses interlocuteurs entendants8. Par exemple, il est déjà arrivé qu’un usager sourd, isolé dans une réunion composée de personnes entendantes, n’ose pas s’exprimer, jusqu’à ce que l’interprète sourd preste son service ; de la même manière, la présence d’une interprète sourde dans la salle de travail, aux côtés de l’équipe médicale, a rassuré une femme sourde durant l’accouchement de son enfant, lui permettant de mieux vivre cette étape importante de l’existence. On retrouve aussi chez ce type de professionnels une plus grande nuance dans la langue et une finesse plus importante dans la grammaire, notamment dans l’emploi des expressions faciales. En ce sens, les interprètes sourds ont, de par leur surdité, plusieurs atouts qui viennent renforcer l’inclusion des personnes sourdes dans la vie de la société. Alors que les interprètes entendants sont, pour la plupart, des personnes extérieures à la communauté (à l’exception de certains cas particuliers de proches devenus interprètes), à l’inverse, leurs collègues sourds sont membres de cette même minorité culturelle et linguistique. De ce fait, les interprètes sourds bénéficient de connaissances propres, issues de leurs propres expériences communautaire, identitaire, culturelle et linguistique. Ces connaissances empiriques, qui ne sont pas apprises sur les bancs des facultés universitaires, permettent aux interprètes sourds de mieux s’adapter à leur public ou à leur usager sourd. Par exemple, la présence d’un interprète sourd peut rendre plus confortable ou rassurant l’échange avec une personne détenant une forme d’autorité (politique, administrative, juridique, scientifique, ou médicale), voire de prestige (artistique, notamment). Ainsi, aux États-Unis, la Maison blanche dispose d’une équipe d’interprètes sourds pour les conférences de presse et les discours du président. On retrouve aussi, dans le milieu culturel américain, des interprètes sourds, individuellement ou en équipe, dans le cadre d’évènements nationaux (comme le Super Bowl) ou encore pour certaines œuvres audio-visuelles, disponibles en diffusion linéaire ou sur certaines plateformes de streaming. En Belgique, des initiatives très ciblées existent au travers de politiques singulières, comme la santé mentale, l’accueil des demandeurs d’asile sourds, ou encore les mesures prophylactiques nationales, comme durant la crise sanitaire liée au covid-19. Même si le public sourd n’a pas toujours immédiatement reconnu les interprètes sourds à la télévision, la période de pandémie a accéléré la normalisation de leur présence à l’écran, puisqu’elles étaient visibles pratiquement tous les jours durant plusieurs mois d’affilée sur les télévisions de chaque ménage belge.
Par ailleurs, les interprètes sourds présentent un réel intérêt pour les personnes sourdes avec un handicap associé. Cette catégorie fort diversifiée et particulièrement vulnérable peut plus aisément entrer en relation avec les interprètes sourds, alors que cet exercice peut devenir une tâche très difficile pour leurs collègues entendants car, après tout, la langue des signes est très rarement leur langue maternelle ou leur première langue. Mais les interprètes sourds peuvent aussi être un atout pour les personnes sourdes plus ordinaires, notamment dans le cadre des communications de masse (comme à la télévision ou lors d’un festival, on l’a dit). La présence d’interprètes sourds peut aussi représenter une valeur ajoutée dans des situations délicates de la vie courante. Ainsi, dans le public présent lors de cette conférence, une personne sourde a témoigné que durant de l’accouchement de son enfant, l’intervention d’une interprète sourde l’a rassurée, alors qu’elle était entourée de personnes entendantes dans l’équipe médicale.
Si la valeur ajoutée de l’interprétation ou de la traduction en langue des signes par une personne sourde est réelle, la visibilisation du métier ad hoc n’en demeure pas moins cruciale. Cette mise en évidence de ce métier émergent ne signifie pas amoindrir le rôle d’ores et déjà exercé par les collègues entendants, mais vise plutôt à laisser une place égale aux deux catégories d’individus dans un même corps de métier, tout en laissant le soin aux personnes sourdes de choisir (dans les limites juridiques existantes) l’interprète qu’elles préfèrent.
B) La diplomation : du certificat vers le master ?
Le métier d’interprète sourd est qualifié d’émergent, car, d’une part, il n’existe pas encore de formation qualitative belge pérenne à ce sujet et, d’autre part, le corps professionnel n’est pas d’ores et déjà entièrement organisé (au sein d’une commission paritaire, d’un syndicat, d’une association ou d’un ordre libéral). Néanmoins, cela ne saurait tarder : l’ABILS s’intéresse de très près aux évolutions de ce nouveau corps de métier. Par ailleurs, la communauté sourde, les pouvoirs publics et la société civile devraient s’inspirer des exemples étrangers, en particulier états-uniens et européens, au sujet de la formation des prochains professionnels sourds de la langue des signes, que ce soit en interprétation ou en traduction. Par exemple, il existe en Europe un master dédié à l’interprétation en langue des signes par les personnes sourdes qui comprend 90 crédits au terme d’une formation de deux années, à savoir EUMASLI9.
Si le besoin d’interprète professionnel est criant au sein de la communauté sourde, se pose tout de même la question de la formation adéquate et du diplôme pertinent. Au-delà d’une reconnaissance du métier par le prestige de l’institution formatrice, un diplôme universitaire de type master garantit surtout la qualité de la formation ainsi que le développement de la recherche scientifique dans les années à venir sur la problématique des interprètes sourds10. Or, cela implique un coût logistique, humain et financier élevé que toutes les universités ne sont pas en mesure de soutenir à court ou moyen terme. En effet, seule l’UCLouvain organise un master en interprétation-traduction de la langue des signes, mais ce dernier est destiné essentiellement aux personnes entendantes. En parallèle, la force des formations diplômantes plus courtes consiste à placer rapidement une main d’œuvre qualifiée à un moindre coût pour la collectivité (mais aussi pour les interlocuteurs entendants qui doivent à leur frais mettre en œuvre un aménagement raisonnable au profit de la personne sourde).
Durant les années 1990 et 2000, le métier d’interprète sourd s’apprenait sur le tard, en réponse immédiate a un besoin urgent. Il n’y avait donc pas de formation certifiée, simplement une pratique plurilingue (en différentes langues des signes), renforcée par une solide expérience de terrain. Ces trop rares interprètes sourds, d’abord semi-professionnels, puis professionnels, ont diversifié leur expertise, s’impliquant au sein de secteurs variés, comme l’accueil de demandeur d’asile sourd (avec FEDASIL) ou encore dans le cadre des cours d’auto-école, dont l’examen du permis de conduire. Certains de ces professionnels autodidactes se sont même spécialisés dans l’interprétation pour les personnes sourdes-aveugles ; il ne faut, au reste, pas confondre un assistant d’une personne sourde-aveugle avec un interprète sourd spécialisé en langue des signes tactile : alors que le premier s’occupe du quotidien de la personne sourde-aveugle, ce dernier ne se soucie que de la communication.
 L’Université de Mons a, en 2017, proposé un projet pilote de formation certificative d’interprétation en langue des signes pour les personnes sourdes. Mais cela n’a pas été reconduit. Toutefois, la crise sanitaire de 2020 et 2021 a constitué un moment charnière qui a accéléré la visibilisation et la reconnaissance du métier de l’interprète sourd, puisque c’est bien ce corps professionnel que des millions de belges ont vu à l’écran tout au long de cette période. Ainsi, en 2023, également dans le cadre d’un projet-pilote, les Universités de Namur, de Saint-Louis-Bruxelles et de Toulouse Jean-Jaurès ont privilégié, à leur tour, la formule du certificat universitaire. Ce choix s’explique par la souplesse de ce dispositif vis-à-vis du public étudiant sourd et de son caractère financièrement soutenable pour les trois institutions. En ce sens, le choix d’un diplôme de formation continue, plutôt que d’un master, permet, à court terme (en un an et demi) de former des personnes qui ont déjà une expérience pratique importante liée au terrain. La valorisation des acquis de l’expérience a permis aux universités d’accueillir des personnes sourdes motivées et dynamiques, capables d’une réflexion critique sur la réalité dans laquelle elles évoluent. Une fois les étudiants inscrits, une première étape a consisté, durant six mois, à renforcer la maitrise de la LSFB et de la langue française ainsi que des compétences en bilinguisme. Par la suite, le reste de la formation a été subdivisé en trois spécialités, à savoir : l’enseignement de la langue des signes et en langue des signes, la traduction et l’interprétation. On notera, cependant, que ce projet-pilote ne prévoit pas de formation dédiée à l’interprétation de la langue des signes tactile, destinée principalement aux personnes sourdes-aveugles.
L’Université de Mons a, en 2017, proposé un projet pilote de formation certificative d’interprétation en langue des signes pour les personnes sourdes. Mais cela n’a pas été reconduit. Toutefois, la crise sanitaire de 2020 et 2021 a constitué un moment charnière qui a accéléré la visibilisation et la reconnaissance du métier de l’interprète sourd, puisque c’est bien ce corps professionnel que des millions de belges ont vu à l’écran tout au long de cette période. Ainsi, en 2023, également dans le cadre d’un projet-pilote, les Universités de Namur, de Saint-Louis-Bruxelles et de Toulouse Jean-Jaurès ont privilégié, à leur tour, la formule du certificat universitaire. Ce choix s’explique par la souplesse de ce dispositif vis-à-vis du public étudiant sourd et de son caractère financièrement soutenable pour les trois institutions. En ce sens, le choix d’un diplôme de formation continue, plutôt que d’un master, permet, à court terme (en un an et demi) de former des personnes qui ont déjà une expérience pratique importante liée au terrain. La valorisation des acquis de l’expérience a permis aux universités d’accueillir des personnes sourdes motivées et dynamiques, capables d’une réflexion critique sur la réalité dans laquelle elles évoluent. Une fois les étudiants inscrits, une première étape a consisté, durant six mois, à renforcer la maitrise de la LSFB et de la langue française ainsi que des compétences en bilinguisme. Par la suite, le reste de la formation a été subdivisé en trois spécialités, à savoir : l’enseignement de la langue des signes et en langue des signes, la traduction et l’interprétation. On notera, cependant, que ce projet-pilote ne prévoit pas de formation dédiée à l’interprétation de la langue des signes tactile, destinée principalement aux personnes sourdes-aveugles.
Conclusion
Pour l’heure, l’interprétation et la traduction en langue des signes par des professionnels sourds relèvent des métiers émergents. Ces services ne sont pas réservés exclusivement aux personnes sourdes les plus vulnérables, mais s’avèrent utiles pour tout un chacun. Demeure la question du droit à une interprétation ou à une traduction par une personne sourde (notamment dans le cadre des aménagements raisonnables). En ce sens, la communauté sourde doit se mobiliser en faveur de la reconnaissance d’un droit à recourir à un interprète ou à un traducteur sourd, seul ou en binôme avec un collègue entendant. La reconnaissance de ces deux métiers passera nécessairement par leur valorisation à travers un parcours dans le cadre de l’enseignement supérieur mis en œuvre par les pouvoirs publics compétents. En plus d’être une source d’emploi pour la communauté sourde et un allègement de la charge de travail pour les interprètes entendants, la professionnalisation des personnes sourdes dans ce secteur d’activités renforce l’autonomie et l’inclusion de leurs pairs dans une société qui tend toujours vers davantage d’égalité de traitement.
Téléchargez cet article en format PDF
1 Décret de la communauté française du 22 octobre 2003 relatif à la reconnaissance de la langue des signes, M.B., 25 novembre 2003, p. 56555.
2 On signale qu’en France, il existe deux parcours d’enseignement qui facilitent la distinction entre ces deux métiers : l’un est destiné à la médiation et l’autre à l’interprétation, sans que ces deux formations ne se recoupent, établissant ainsi une claire différence entre les deux professions sur le marché de l’emploi et dans la communauté sourde française.
3 À ce sujet, voy. Hanquet N. & le Maire D. (2021). Co-interprétation sourd et entendant. L’union fait la force. Traduire, 245, p. 86-98. https://doi.org/10.4000/traduire.2470; Hanquet N. & Gomes B. (2024). Quel « nous », dans le « rien sur nous sans nous ». Analyse du cas particulier des interprètes en langue des signes. Y. Cartuyvels et al. (dir.). In L’autonomie à l’épreuve du handicap, le handicap à l’épreuve de l’autonomie, à paraître ; Gomes, B. & Heylens, A. (2021). Langue des signes et droit à l’information des personnes handicapées. Les enseignements de la communication de crise en Belgique au cœur de la pandémie du SRAS-CoV-2. Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 87, 59-89. https://doi.org/10.3917/riej.087.0059.
4 À ce sujet, voy. : Bloxs, A. & Stone, C. (2024). Le droit à l’inclusion des personnes sourdes à travers le recours à la langue des signes. Y. Cartuyvels et al. (dir.). In L’autonomie à l’épreuve du handicap, le handicap à l’épreuve de l’autonomie, à paraître.
5 Cf. à ce sujet : FFSB, « Les aménagements raisonnables – Présentation d’UNIA et témoignage d’une expérience individuelle », Bruxelles, FFSB, 2024 ; Fiche informative au sujet des aménagements raisonnables en matière de handicap, disponible sur le site de la FFSB.be http://www.ffsb.be/amenagements-raisonnables/
6Il faut aussi tenir compte du fait qu’en raison de leur public largement diversifié, certains débiteurs n’ont pas d’autres choix que de recourir à la co-interprétation, comme le Centre fédéral de crise ou encore le FEDASIL, pour les pouvoirs publics, ainsi que certaines ONG humanitaires, comme la Croix-rouge, Médecins du Monde, etc.
7De Meulder, M. & Heyerick, I. (2013). (Deaf) Interpreters on television: Challenging power and responsibility. In L. Meurant, A. Sinte, M. Van Herreweghe & M. Vermeerbergen (Ed.), Sign Language Research, Uses and Practices: Crossing Views on Theoretical and Applied Sign Language Linguistics (pp. 111-136). Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9781614511472.111; Adam, R., Stone, C., Collins, S. D., & Metzger, M. (Eds.). (2014). Deaf Interpreters at Work: International Insights. Gallaudet University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv2t5xgm8.
8Au sujet des blocages psychologiques ou symboliques à la participation de la personne sourde à la vie de la société, voy., en particulier : Biedma, R. (2007). Ça ne va pas être possible, tu es sourd ! Éditions du Lys, Montpellier.
9 Eumasli – International master programme (consulté le 20 août 2024). Ce master européen est organisé par trois universités, réparties entre le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Finlande.
10Parmi les questions posées par le public méritant une problématique de recherche, l’une d’entre elles porte sur la comparaison de l’adaptation culturelle des interprètes sourds entre deux langues des signes et des interprètes entendants entre deux langues-audio-vocales.